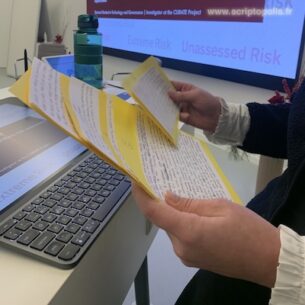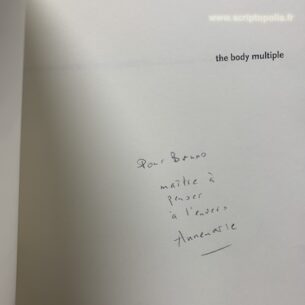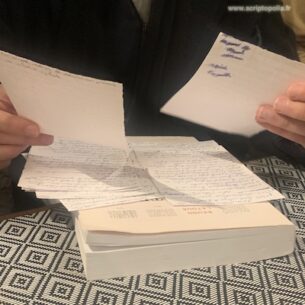Contributions
Genève, septembre 2025.
La visite se passait jusqu’alors sur des installations muséifiées ou avec des représentations très simplifiées des infrastructures de milliers de tonnes se trouvant 50 m sous nous. Et puis, soudain, après que notre guide a appuyé sur un bouton, la vitre opaque devant nous s’est éclairée de la lumière de la salle de contrôle d’ATLAS, l’un des 4 détecteurs branchés sur le gigantesque anneau où circulent les particules à des vitesses folles.
Là, des travailleurs face à une myriade d’écrans affichant des indicateurs, le résultat de multiples capteurs et, toutes les 5 secondes, une nouvelle image d’une collision venant d’avoir lieu sous terre s’affiche sur le mur opposé. Tout est au vert, l’ambiance est calme, seulement perturbée par les bruits générés par notre visite. Tant que les expériences durent, il faut que des humains surveillent l’ensemble des processus. Aussi, comme dans d’autres industries, ils et elles se relaient toutes les 8 heures.
Ces travailleurs ne sont pas spécialisés dans les tâches de contrôle, ce sont des membres du collectif ATLAS, qui regroupe plus de 3 000 physiciens. Pour les inciter à passer 8 h de suite face à ces écrans plutôt qu’à analyser des données ou écrire un article, les règles sont simples. À chaque service ainsi rendu, des points sont ajoutés sur leur compte ; si le service est effectué de nuit ou le week-end, les points sont multipliés. Ainsi, plutôt qu’une séparation entre petites mains invisibles et auteurs starifiés, le collectif mesure les contributions comme il mesure les particules. Si tout le monde pose sa signature, par ordre alphabétique, sur l’article, c’est celle ou celui qui a le plus sacrifié à la surveillance des multiples écrans qui obtient la grande récompense : présenter une communication en colloque au nom du collectif.